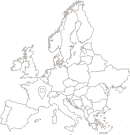Projet de recherche DPTS2026Droit(s) et Politique(s) du Travail Sexuel 2026
Projet de recherche ANR porté par le CERCRID (UMR 5137)
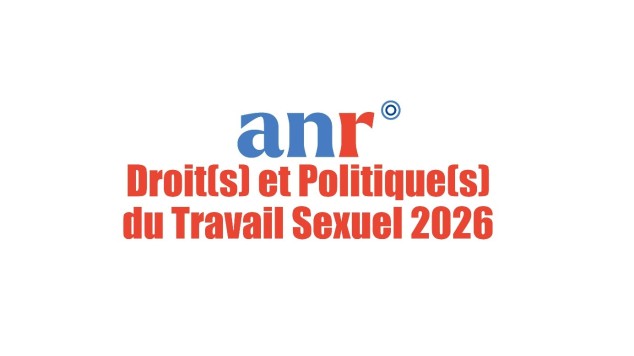
Le projet "Droit(s) et Politique(s) du Travail Sexuel 2026" (DPTS2026) est une initiative de recherche-action participative financée par l'Agence Nationale de la Recherche (France). Il réunit chercheur·ses de toute discipline, associations de travailleur·ses du sexe et organisations alliées (notamment Parapluie Rouge, Médecins du Monde) afin d’élaborer une proposition de loi sur la base de l’état de l’art scientifique et d’une consultation communautaire. L’atelier, organisé en partenariat avec le CRID&P de l’UCLouvain et la Faculté de Northumbria, contribuera à la robustesse des résultats.
L'ÉQUIPE DPTS 2026
Coordination scientifique :
Benoît SCHMALTZ, Maître de conférence en droit public, CERCRID, UMR 5137, Univ. Jean Monnet Saint-Etienne
Universitaires :
Arnaud CASADO, Université Paris 1, ISST
Hélène LE BAIL, Sciences Po, CNRS, LIEPP
Céline BELLEDENT, UJM, Centre Max Weber
Dominique LAGORGETTE, Université Savoie-Mont-Blanc
Samantha PRATALI, Institut Catholique de Lille
Thomas PRIEUR, UJM, CERCRID
Raphaël SERRES, Université Grenoble Alpes
Associatifs :
Aksel
Berthe DE LAON, Fédération Parapluie Rouge
Cybèle LESPERANCE, Tullia
Sarah Marie MAFFESOLI, Médecins du Monde
Tiers-Veilleuse :
Hélène CHAUVEAU, La Boutique des Sciences, Lyon 2
Atelier transdisciplinaire international « Dignity by Design for Sex Workers » des 8-10 octobre 2025
Voir l’appel à manifestation d’intérêt
Formulaire de participation / Participation form :
https://forms.office.com/r/wELYY697a4
Contact : benoit.schmaltz@univ-st-etienne.fr (benoit.schmaltz @ univ-st-etienne.fr)
Afin de contribuer aux travaux du projet DPTS2026, l’atelier transdisciplinaire international « Dignity by Design for Sex Workers » des 8-10 octobre 2025 réunira des chercheurs et chercheuses et des travailleurs et travailleuses du sexe, ainsi que toute personne travaillant, étant concernée ou étant intéressée. Les thématiques de travail identifiées sont les suivantes :
Perspectives comparées du travail sexuel
- Politiques publiques comparées
- La réforme belge (partenariat avec l’UCLouvain)
- Le cadre européen (UE, CEDH)
Méthodologie et recherche
- Méthodes quantitatives vs qualitatives
- Méthodes participatives
- Approche par les risques
- Epistémologie et positionnements
Approches multidisciplinaires
- Concepts liés au TDS (définitions & catégories)
- Analyse comparative et design des politiques publiques
- Limites au TDS : comportements pénalisés
- Conditions de travail et protection sociale
- TDS comme activité indépendante (contrat de service, entreprenariat)
- Fiscalité et TDS
- TDS & gouvernance locale (droit administratif, urbanisme)
- Dimension numérique du TDS
- TDS & migrations
Contexte et présentation du projet DPTS2026
Le travail sexuel englobe toute activité professionnelle à but lucratif impliquant un acte ou une relation sexuelle accompli(e) en contrepartie du versement d’un prix, quelle qu’en soit la forme. La « prostitution », en particulier, fait l’objet d’une forte stigmatisation sociale reflétée par un traitement juridique qui, le plus souvent, manifeste une forme de mépris pour les personnes concernées et conduit à méconnaître leurs droits fondamentaux par l’aggravation de leurs conditions de vie et de travail. À travers le monde, des activités criminelles plus ou moins organisées profitent de l’exploitation sexuelle de nombreuses personnes, souvent rendues plus vulnérable par le traitement également problématique de la migration. La confusion entre travail sexuel et traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle réduit la capacité des États à lutter contre la criminalité tout en garantissant les droits des personnes vulnérables.
En France, la loi du 13 avril 2016, inspirée du « modèle » suédois, pénalise l’achat d’acte sexuel et propose un parcours de sortie dans l’espoir d’une « société sans prostitution ». Dix ans après son application, les conséquences négatives pour la situation concrète des personnes concernées invitent à une analyse critique et la formulation de possibles évolutions, sans impact réel sur la réduction des situations d’exploitation.
En Belgique à l’inverse, et à la suite des Nouvelles Galles du Sud en 1995 la Nouvelle-Zélande depuis 2003 (sauf pour les personnes migrantes), les activités de travail sexuel ont, hors exploitation, mineurs et étudiant.e.s, été dépénalisées par la loi du 21 mars 2022. Fruit de compromis et adoptée après d’intenses discussions, cette réforme unique en Europe soulève à présent des difficultés de mise en œuvre, par exemple avec la question du contrat de travail sexuel salarié dont la législation émerge avec une première loi de 2024.
Touchant à l’intime de la nature humaine, le phénomène du travail sexuel suscite des recherches et des controverses partout à travers le monde. La marginalisation associée à la stigmatisation ne touche cependant pas seulement les personnes concernées mais parfois également les membres de la communauté académique. Cela suscite un besoin d’institutionnaliser un champ d’autant plus légitime qu’il porte sur des tendances lourdes de nos sociétés marquées par l’illibéralisme, la polarisation et la perte de repères éthiques.
En réponse à ces différents enjeux, « Droit(s) et Politique(s) du Travail Sexuel 2026 » est un projet de recherche-action transdisciplinaire réunissant un consortium de chercheurs (juristes et autres SHS) et d’associations de travailleuses du sexe (Fédération Parapluie Rouge) ou alliée (Médecins du Monde). Il a obtenu un financement de l’Agence Nationale de la Recherche en répondant à l’appel Sciences Avec et Pour la Société (ANR-SAPS-RP2-2025) en raison de sa démarche participative. L’objectif du projet est de contribuer à la robustesse juridique et scientifique de la proposition de loi qui sera portée par les associations, tout en s’inscrivant dans la recherche en sciences juridiques et sociales sur le travail sexuel. La proposition de loi sera accompagnée d’un rapport universitaire en plus des livrables traditionnels (colloque, articles, ouvrage). Une consultation communautaire est au cœur des travaux préparatoires de cette proposition qui sera ouverte à la critique et à la discussion publique en mars 2026.
Benoît SCHMALTZ
benoit.schmaltz @ univ-st-etienne.fr