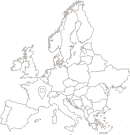Projet de recherche PROTRANSLa parenté procréative transgenre
Projet financé par l’IERDJ, l’Institut du genre, la DILCRAH, l'Université Lumière Lyon 2, le CERCRID (UMR 5137) et le CEDCACE (EA 3457)

Résumé du projet
Contexte et nécessité de la recherche
Le projet PROTRANS s’inscrit dans le champ du droit et plus largement des sciences sociales. Il vise à accroître les connaissances sur la parenté transgenre procréative.
Le concept de parenté transgenre procréative, ici utilisé, est avant tout un concept juridique. Il doit être compris comme un lien de droit entre un ou une ascendante transgenre et son ou sa descendante biologique au premier degré. Juridiquement cette parenté procréative se distingue de la parenté adoptive ou d’autres liens pouvant exister entre des adultes et des enfants, mais créant moins de droits et de devoirs (comme le fait d’être « beau-parent »).
En croisant différentes données relatives au nombre de personnes transgenres dans la population française (selon les données de l’état civil [Borrel et Moron-Puech 2023)] ou de l’assurance maladie [H. Picard et S. Jutant 2022]) au pourcentage de personnes transgenres prenant part à l’éducation d’un·e enfant (https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer) ou consultant les associations pour avoir accès à des informations sur leurs droits sur les enfants qu’elles pourraient mettre au monde, on peut raisonnablement penser que le phénomène de la parenté transgenre procréative est de l’ordre de quelques centaines en France. Ce n’est donc pas un « cas d’école ». D’où des difficultés réelles, en l’absence de règles françaises claires en matière d’accès des personnes transgenres à l’assistance médicale à la procréation (AMP) comme à l’autoconservation des gamètes, d’une part, et d’établissement comme de publicisation de la filiation, d’autre part.
Les difficultés des juridictions françaises à appréhender la parenté transgenre procréative se retrouvent également dans d’autres pays. Or, lorsque les contentieux survenant à l’étranger sont traités dans les médias français ou qu’ils « remontent » jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme, comme ce fut par exemple le cas en avril 2023 pour des affaires allemandes, cette « publicité » a nécessairement une influence sur la perception du sujet en France. Une autre manifestation de la globalisation de cette question provient de la double circulation suivante, qui se développe avec la protection affirmée des institutions européennes : circulation des familles transgenres qui peuvent parfois voyager en Europe pour avoir accès à une AMP fermée dans leur pays ; circulation aussi des gamètes eus-mêmes. Or dans tous ces cas, cette circulation, régie par le droit international privé (Karsay 2021 et Moron-Puech 2021) et le principe de liberté de circulation, conduit à envisager la question au-delà du seul cadre défini par le droit français.
La réalisation de ce projet de recherche est nécessaire à plusieurs égards. Du point de vue scientifique, les travaux français sur ce phénomène social manquent, en atteste la rareté dans la littérature des occurrences de l’adjectif « transparental » (3 occurrences au 8 avril 2024 dans la base de données Cairn, avec seulement un article traitant directement du sujet [Marchand 2017]). Plus généralement, la recherche sur la transidentité est un champ émergent, pour lequel des appels au financement de la recherche sont fréquemment formulés. La nécessité du projet est également juridique. En effet, s’observe une nette hésitation des acteur·rices du droit sur la manière dont il conviendrait de traiter la question. Ainsi, dans un même contentieux, où quatre juridictions françaises ont été saisies, toutes ont apporté des réponses différentes ! Tout ceci semble témoigner de l’hésitation de ces acteur·rices sur l’appréhension de la parenté transgenre. Pour finir, même lorsque des travaux scientifiques existent, ceux-ci demeurent peu connus. Cela transparaît, par exemple, nettement des travaux parlementaires de la loi dite « J21 » du 18 novembre 2016, premier texte à avoir traité du sujet. Ainsi, pour justifier de ne pas traiter de la filiation des enfants né·es postérieurement au changement de sexe d’une personne transgenre, il a été défendu qu’ « un tel cas ne devrait être qu’exceptionnel (la situation s’est rencontrée au Canada), dans la mesure où, dans les cas de transsexualisme avéré, l’intéressé vivrait comme une contradiction flagrante d’être devenu parent selon son sexe d’origine et non selon celui qu’il a choisi » (Rapp. Sénat 2016, n° 839). Or, cette affirmation est en décalage avec les méta-analyses scientifiques disponibles (Stolk T.-H.-R. et al. 2023). Une recherche sur ce sujet permettrait non seulement d’éclairer les acteur·rices du droit mais aussi toutes les personnes intervenant dans cette matière.
Problématique et hypothèses de la recherche
La problématique de ce projet est la suivante : comment la parenté transgenre procréative est-elle appréhendée par les différentes institutions, organisations et individus qui y sont confrontés ?
La principale hypothèse sous-tendant cette problématique est la suivante : la parenté transgenre procréative demeure délicate à appréhender pour les institutions et personnes qui y sont confrontées en raison de la confusion persistante des catégories liées aux caractéristiques sexuées d’une part et au genre d’autre part. Cette parenté réinterroge les catégories sociales fondamentales de « père », de « mère » et le système juridique de filiation bâti dessus. Ainsi, malgré la suppression de la condition de stérilisation comme préalable à la transition sociale il paraît subsister l’idée qu’une personne transgenre aurait forcément perdu ses caractéristiques sexuées d’origine.
Une seconde hypothèse sous-tendant la problématique est que le traitement de la question juridique de la parenté transgenre procréative n’est pas stabilisé et ne dépend pas de normes juridiques nettement fixées. Le traitement donné à l’avenir à la question de la parenté transgenre procréative dépendra sans doute des mobilisations des différents groupes sociaux auprès des diverses instances, des arguments mobilisés (scientifiques et juridiques) et de la réception par les instances de leur action.
Axes et objectifs d’une recherche pluridisciplinaires
Seule une approche pluridisciplinaire permettra d’éprouver ces hypothèses et de répondre à la problématique posée. À cette fin, la recherche sera construite autour de trois axes.
Dans un premier axe, on cherchera à comprendre et documenter les incertitudes contemporaines du droit positif tant normatif que jurisprudentiel, à savoir celles concernant l’accès aux techniques d’AMP lato sensu et celles relatives à la filiation.
Dans un deuxième axe, on s’attachera davantage aux représentations sociales de la parenté procréative transgenre (largement dans les médias – à l’aide d’outils d’analyse lexicométrique – et au sein de la population en général et plus précisément chez les acteur·rices confronté·es à la parenté procréative transgenre, en cherchant à tenir compte des caractéristiques sociales des investigué·es de nature à les influencer).
Dans un troisième axe, notre attention sera portée vers les évolutions à venir. Pour ce faire, on s’intéressera aux différents modèles d’encadrement de la parenté transgenre apparaissant dans d’autres ordres juridiques (droit comparé) ainsi qu’aux propositions doctrinales françaises, tout en prêtant attention aux contraintes qu’exercent le droit international des droits humains, le droit international privé et le droit de l’Union européenne sur le droit français. Dans le cadre de cette réflexion, on examinera les mobilisations sociales à l’œuvre, qu’elles soient réformatrices ou conservatrices.
Au terme de cette recherche, on espère atteindre les objectifs suivants :
- Réaliser un état des lieux du droit positif français, en tentant d’en mieux comprendre les spécificités et d’en anticiper les évolutions, notamment grâce au droit comparé ;
- Dévoiler, dans leur diversité et leur complexité, les pratiques encore peu visibles en France des institutions judiciaires, médicales et administratives relatives à la parenté procréative transgenre, ainsi que les logiques sous-tendant les choix des acteur·rices ;
- Documenter la réception de ces pratiques et les réactions qu’elles suscitent chez les personnes transgenres, leur(s) conjoint·e(s) lato sensu, leurs enfants et les associations les représentant.
Méthodes de la recherche
Pour atteindre ces objectifs, seront combinées les différentes méthodes tirées avant tout des disciplines du droit, de la sociologie, de l’anthropologie et de la psychologie sociale.
À cet égard, plusieurs entretiens seront réalisés. Le traitement des données qui en seront issues respectera les règles de l’éthique professionnelle, le libre consentement des participant·es, l’anonymat et la confidentialité. Les règles du RGPD et les recommandations de la CNIL pour la sécurisation et la durée de conservation de ces données sont suivies en lien avec les délégués aux données personnelles (DPO) des différentes Universités dont sont membres les chercheur·es de l’équipe. Les données ne seront pas rendues publiques et ne seront utilisées à aucune autre fin que la recherche.
Afin de comprendre la manière dont les incertitudes du droit relativement à la parenté procréative transgenre sont nées et pourraient être résolues, des entretiens seront réalisés avec les acteur·rices clefs identifié·es (parlementaires, conseiller·es, membres des administrations, etc.). Par ailleurs, afin de comprendre les difficultés d’application du cadre juridique actuel, des entretiens seront réalisés avec des professionnel·les du droit ayant été confronté·es à la situation de la parenté transgenre procréative (profession d’avocats, de notaires, de magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, d’officiers d’état civil, etc.). Il en sera de même pour le traitement de ces demandes par les institutions médicales (notamment les professionnel·les des CECOS ou de l’Agence de la biomédecine).
Afin de comprendre l’expérience des personnes transgenres en matière de parenté et la manière dont les incertitudes et leurs représentations sociales du droit influent sur leurs comportements, plusieurs entretiens non directifs seront réalisés avec des personnes ayant eu ou s’apprêtant à mener un projet parental. Le but consiste à documenter la diversité des expériences et des points de vue, afin d’en comprendre l’essentiel. En outre, lorsque cela sera possible, le point de vue des proches pourra être recueilli pour saisir l’expérience de la parenté transgenre dans sa globalité.
Enfin, il sera fait une place à l’expérience associative via des « focus group », où seront collectées les dynamiques sociales accompagnant les prises de position des individus au sujet de la parenté transgenre, du droit de filiation, de l’accès AMP et de l’accompagnement des familles (Markova 2003).
Equipe de recherche
Direction scientifique
- Julien BOISSON, Maître de conférences en droit privé, Université Paris Nanterre, CEDCACE
- Benjamin MORON-PUECH, Professeur agrégé en droit privé, Université Lumière Lyon 2, CERCRID
Membres de l’équipe
- Anne-Sophie BRUN-WAUTHIER, Maître de conférences en droit privé, Université Grenoble Alpes, CRJ
- Jérôme COURDURIÈS, Professeur des universités en anthropologie, Université Toulouse Jean Jaurès, LISST
- Christine DOURLENS, Maîtresse de conférences HDR émérite en sociologie, Université Jean Monnet Saint-Etienne, Triangle
- Elsa FONDIMARE, Maîtresse de conférences en droit public, Université Paris Nanterre, CTAD – CREDOF
- Samuel FULLI-LEMAIRE, Professeur agrégé en droit privé, Université de Strasbourg, CDPF
- Christèle FRAÏSSÉ, Maîtresse de conférences en psychologie sociale, Université de Bretagne Occidentale, LP3C
- Laurence HÉRAULT, Professeure des universités en anthropologie, Aix-Marseille Université, IDEMEC
- Clovis MAILLET, docteur de l’EHESS en histoire et chargé de cours à la HEAD Genève (HES-SO)
- Julie MATTIUSSI, Maîtresses de conférence en droit privé, Université de Strasbourg, CDPF
- Pierre MICHEL, Maître de conférence en droit privé, Université de Lyon 2, Transversales
- Régis SCHLAGDENHAUFFEN, Maître de conférences HDR en sociologie, EHESS, IRIS
- Raphaëlle THÉRY, Maîtresses de conférence en droit privé, Université Panthéon-Assas, Laboratoire de sociologie du droit
Ingéniaires d’étude et de recherche
- Thomas PRIEUR, psychologue social chargé d'études, CERCRID
- Chloé SUSSAN-MOLSON, Ingénieuse d'études en production, traitement, analyse de données et enquêtes, CERCRID
- Hussein FLEURY-KHALIFE, doctorant en droit privé, Université Panthéon-Assas, CERCRID

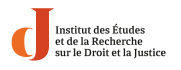

PROTRANS
protrans @ univ-lyon2.fr
Benjamin MORON-PUECH
benjamin.moron-puech @ univ-lyon2.fr
Julien BOISSON
jboisson @ parisnanterre.fr