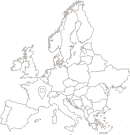Publication du rapport de recherche "Le contrôle de la recherche d’emploi : normes, agents, contentieux"Sous la direction scientifique de Laure CAMAJI et Claire VIVÈS
Recherche collective menée de 2008 à 2024 par le CERCRID (UMR 5137), le CNAM - Conservatoire National des Arts et Métiers, et le CEET - Centre d'Etudes de l'Emploi et du Travail, avec un financement du Ministère de la Justice (Institut des Études et de la Recherche sur le Droit et la Justice).
Le contrôle de la recherche d’emploi est devenu depuis une dizaine d’années une composante importante de la lutte contre le chômage, une évolution qui s’accélère en raison des orientations données lors du passage de Pôle emploi à France Travail. Bien que la procédure de contrôle ait des conséquences cruciales pour des centaines de milliers de demandeur·ses d’emploi, elle demeure à ce jour très peu étudiée. Partant de ce constat, cette recherche prend pour objet le contrôle de la recherche d’emploi dans ses différentes dimensions politiques, administratives, règlementaires et judiciaires, à l’appui d’une méthodologie pluridisciplinaire combinant sociologie, science politique et droit.
Trois principaux résultats émergent de ce travail :
Premièrement, le Code du travail ménageant des marges d’interprétation importantes de la notion de « recherche active d’emploi », le contrôle des chômeur·ses constitue le lieu principal de construction du sens normatif de l’obligation de recherche d’emploi. Les règles applicables découlent de dispositifs organisationnels, d’outils de gestion implémentés dans le système informatique, plutôt que d’une mise en œuvre affichée du pouvoir règlementaire de Pôle emploi. Cette organisation du contrôle trie les publics et oriente les pratiques. Elle façonne les représentations du « bon chômeur », tant au sein de l’opérateur public que vis-à-vis de ses interlocuteurs extérieurs, des personnels en charge de l’accompagnement des chômeur·ses jusqu’aux juridictions administratives, en passant par les cabinets ministériels.
Deuxièmement, nous avons dévoilé la façon dont s’opère concrètement le contrôle, c’est-à-dire la façon dont sont opérationnalisées et mobilisées au quotidien les règles fixées par la loi et l’institution. Les plateformes de contrôle de Pôle emploi sont traversées par une tension entre une rationalisation croissante du processus d’instruction (augmentation de la cadence, ciblage sur les métiers dits « en tension », formalisation des outils de gestion, etc.) et le maintien de variations importantes dans les pratiques et les jugements des agent·es en charge du contrôle. Le management de proximité s’efforce d’homogénéiser l’activité afin d’obtenir des résultats conformes aux objectifs chiffrés annuels de plus en plus élevés fixés par le gouvernement et la direction générale de France Travail.
Enfin, nous avons montré que le parcours contentieux des usager·ères est marqué du sceau de la mise à distance et de la spécialisation. De la réclamation contre la sanction à la décision juridictionnelle, en passant par la médiation préalable obligatoire, les procédures relèvent pour l’essentiel d’un régime d’exception. Celui-ci est justifié tantôt par la préservation de justiciables supposés vulnérables, tantôt au nom de la préservation d’un système judiciaire à bout de souffle. En définitive, l’accumulation de ces dispositifs dérogatoires au droit commun interroge le matériau sur lequel statue le juge et limite considérablement les remises en cause des opérations de contrôle.
Consulter la synthèse et le rapport de recherche
Laure CAMAJI
laure.camaji @ univ-lyon2.fr